Le port de Sciacca est principalement dédié à l’activité de pêche et au commerce. Il accueille environ 500 embarcations, entre bateaux de pêche et petites barques, qui débarquent chaque année plus de 4 000 tonnes de poisson bleu après leurs sorties en mer.
Les techniques de pêche pratiquées dans cette zone sont : le chalutage, la pêche côtière et la palangre.
La variété la plus couramment pêchée appartient à la famille du poisson bleu capturé au cianciolo ; celui-ci est ensuite transformé à terre par les nombreuses conserveries locales et exporté dans le monde entier, faisant de Sciacca le premier producteur européen.
C’est un véritable festival bruyant et sensoriel lorsque les bateaux accostent le long du grand quai du port de Sciacca : des tonnes de poissons et fruits de mer frais sont déversées sur la jetée, qui devient alors une place animée, un marché à ciel ouvert.
Le rideau se lève sur un spectacle typiquement méridional, aux couleurs intenses, où les pêcheurs se transforment en marchands théâtraux offrant leurs produits scintillants de reflets rouge-or-argent.
La mer turquoise et la vieille ville de Sciacca composent un décor unique, tandis que l’air prend une saveur du Sud lorsque la brise saline rencontre les rayons du soleil.





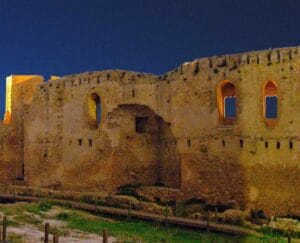 Le Château Luna
Le Château Luna
 Les Portes de Sciacca
Les Portes de Sciacca Le Château Enchanté
Le Château Enchanté
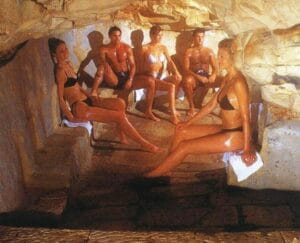 Les “Stufe di San Calogero”
Les “Stufe di San Calogero”
 Le Corail de Sciacca
Le Corail de Sciacca
 Le Carnaval de Sciacca
Le Carnaval de Sciacca 
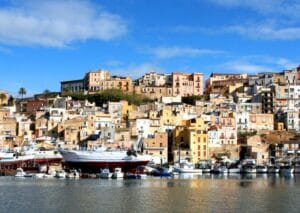 Le Port de Sciacca
Le Port de Sciacca
 La Céramique de Sciacca
La Céramique de Sciacca

 Les Plages de Sciacca
Les Plages de Sciacca L’Île Ferdinandea
L’Île Ferdinandea
